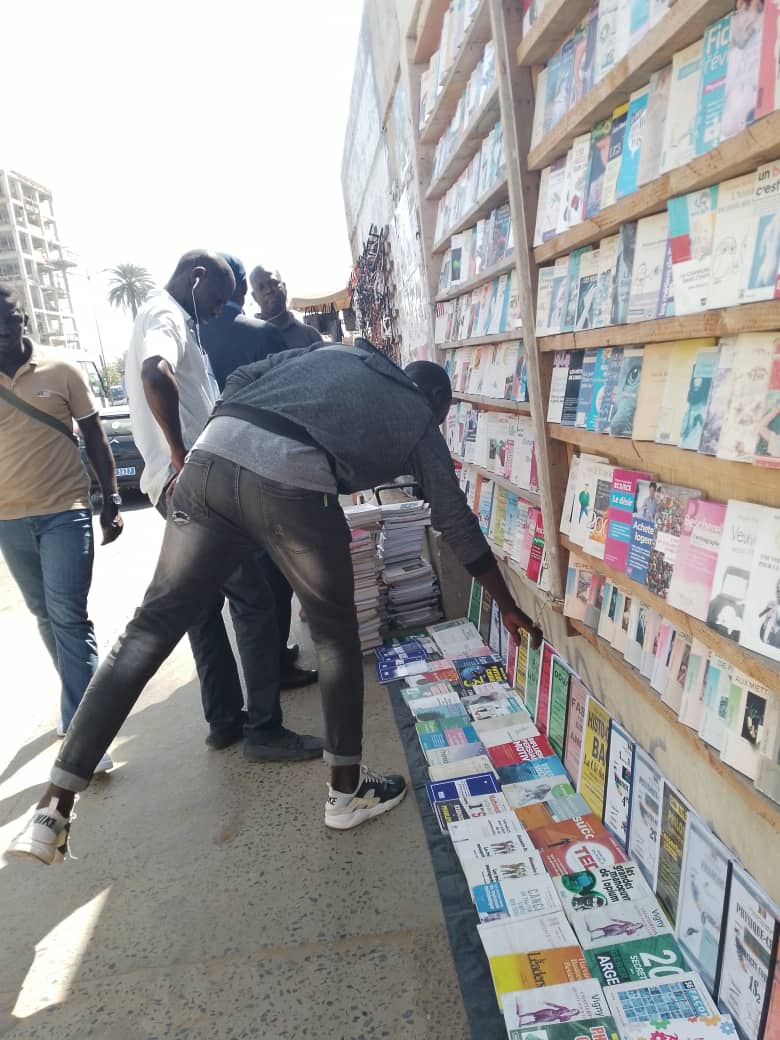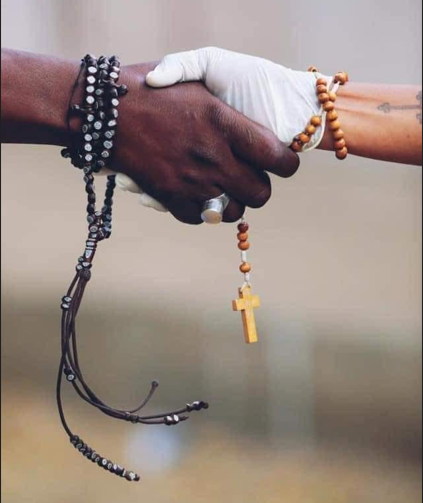L’hôpital de Ninéfécha déclassé en poste de santé

Situé à 40 kilomètres de la ville de Kédougou, l’hôpital de Ninéfécha a été inauguré en novembre 2002 avant de fermer porte un an après la débâcle du régime Wade dont Viviane Wade, alors première dame, par l’entremise de sa fondation Education/santé, était la promotrice. Il n’a été rouvert au public qu’après plusieurs mois de fermeture grâce à l’appui de l’ONG World Vision et a été déclassé en poste de santé en 2014 et intégré dans le système sanitaire de la région de Kédougou. Aujourd’hui de cet hôpital, jadis tant convoité, il n’en reste que des regrets et de beaux souvenirs.
Enclavé dans les montagnes, qui dominent les vieilles bâtisses désertées progressivement dès 2013, rendant ainsi l’accès difficile pour les villages environnants, la commune de Ninéfécha revêt des facettes culturelles multiples marquées notamment par le métissage des peuplades bedik et peul qui cohabitent harmonieusement dans ce bourg. A travers son hôpital, ce village était devenu dès 2003 une destination importante. Aussi bien des touristes que des patients venant de divers horizons y convergeaient dès l’aube de sa mise en place. Ces bâtiments, qui sortaient de terre embourgeoisaient tout d’un coup les habitants qui, naguère, ne connaissaient que des cases de fortune.
Hormis l’agriculture et l’élevage, activités économiques principales dans la contrée, la population s’active très brièvement dans la recherche de l’or. D’où la faiblesse des revenus. « Auparavant, nous étions habitués à la gratuité des soins, maintenant on ne comprend plus rien », martèle une dame bedik, bijoux pleins les oreilles (sous couvert de l’anonymat) trouvée au forage non loin du poste de santé. « On est obligé de participer même pour acheter le carburant de l’ambulance en cas d’urgence », se désole-t-elle.
La débâcle du régime Wade a installé de facto une angoisse sociale chez la population, la contraignant ainsi à arpenter les montagnes, pour certains, avec des moyens de locomotion très rudimentaires pour accéder au minimum de service sanitaire. Aujourd’hui l’hôpital ne peut compter que sur l’appui de la collectivité, unique partenaire et intermédiaire entre les bras techniques et la population.
Cependant Samba Diallo, l’infirmier chef de poste (ICP) affirme ne pas sentir véritablement l’engagement de la collectivité. « Faute de ressources peut-être », martèle-t-il. Si ce joyau disposait auparavant de bloc opératoire, d’une maternité avec hospitalisation, d’une chaise dentaire, d’une case de soins et de logements pour médecins et infirmiers ainsi que d’autres personnels y opérant, aujourd’hui il n’en reste que l’ombre pesante remémorant tristement, à travers la vétusté aussi bien des véhicules que les bâtiments, une ère aussi belle qu’éphémère.
Une disproportion étrange
L’hôpital déclassé en poste de santé doit désormais assurer le minimum des premiers soins pour environ 25 villages. « La situation est un peu pénible, car nous sommes 2 personnes qualifiées dont la sage-femme qui elle, est gérée par la collectivité qui la rémunère. Le reste, c’est le personnel socio-sanitaire qui ne peut pas assurer valablement la continuité du service en cas d’absence de l’un d’entre nous », révèle Samba Diallo, trouvé à son domicile. « C’est très insuffisant au regard de la taille de la population qui dépasse largement les 10 000 habitants », ajoute-t-il.
Malgré les conditions climatiques et géographiques difficiles, le personnel médical si minime qu’il soit, s’active à venir à bout de quelques pathologies telles que le paludisme, l’hypertension artérielle entre autres. Cela, dans la mesure des moyens sur place, indique l’infirmier chef de poste. Avant de poursuivre, « parfois on est confronté à des cas qui demandent à être gérés par des spécialistes. C’est alors que se pose le problème des véhicules. Il nous arrive parfois d’être appuyés par le chauffeur du maire pour évacuer les malades dans la structure adéquate, d’autant que l’ambulance du poste n’est pas toujours en bon état », renseigne-t-il.
En réalité, d’après les explications de l’ICP, l’hôpital vivait absolument sous perfusion des bailleurs, français pour la plupart. En effet ces derniers se sont retirés progressivement dès les lendemains de l’alternance de 2012. C’était une sorte de propriété privée et donc ne dépendait pas du ministère de la Santé et de l’Action sociale d’où le problème de la continuité des services.
Ceux qui étaient aux commandes n’établissaient qu’un budget de fonctionnement et l’envoyaient systématiquement aux bailleurs notamment des ONG. « Des documents de la comptabilité trouvés sur place renseignent sur les anciennes pratiques au sein de la structure. Il en est de même des agents qui y travaillaient pour la plupart sans contrat. », fait remarquer l’ICP.